
L’individu et le groupe
Au cycle 3, les enfants acceptent de jouer avec des règles communes, mais ils ne peuvent légiférer sur tous les cas possibles. La somme des connaissances des élèves de la classe permet toutefois un consensus entre tous. Peu à peu d'ailleurs, les enfants éprouvent un intérêt certain pour la règle comme telle.
On peut remarquer que l'abord de la pratique sportive est orienté par les représentations (très souvent télévisuelles) de telle ou telle activité : le tir au but au football, le tir smashé au basket, et que cela occulte tout ce qui se passe avant.
L'exploit individuel supplante souvent l'aspect collectif du jeu. C'est là que l'enseignant va pouvoir intervenir dans le domaine de l'apprentissage de la vie sociale : en répartissant les rôles de chacun suivant les capacités, en donnant sa part de responsabilité au joueur organisateur, en suscitant une aide à l'apprentissage réciproque entre les élèves, et en demandant aux enfants, chacun leur tour, de ranger les ballons, ramasser les maillots et les dossards...
Un autre aspect de la coopération à ne pas négliger est constitué par l'ensemble des interactions positives à l'intérieur d'un groupe. Ce qui se manifeste par une aide concrète, manuelle, pour soutenir le camarade en difficulté, ou par une stimulation donnée par la réussite du plus habile (image motrice) complétée par ses conseils oraux.
Comment organiser sa classe pour les activités entrant dans ce thème
Dans tous les cas, il faut gagner du temps et être opérationnel très rapidement. L'enseignant doit donc s'appuyer sur des équipes stables dont le rapport de force doit être équilibré.
Toutefois, deux raisons peuvent l'amener à modifier cette façon de procéder
‑ le moment dans l'année,
‑ le type d'activités proposées.
* En début d'année, quand on ne connaît pas les élèves, il y a un moyen très simple et rapide de constituer ses équipes : ranger les enfants du plus petit jusqu'au plus grand, sur une seule file. Donner des numéros de 1 à 2, de 1 à 3, de 1 à 4 suivant les besoins. Les mêmes numéros se retrouvent donc dans la même équipe. Exemple : constituer 4 équipes avec une classe de 24 élèves rangés par ordre de grandeur. Voici ce que l'on obtient

* Quand on connaît les élèves ‑ grâce à l'observation de tous les jours, pour détecter les leaders, les lieutenants, les bons soldats etc. (cf. « Thèmes transversaux Cycles 1 et 2 »),
‑ ou grâce à des évaluations plus ou moins objectives (parcours de capacités, parcours de débrouillardise, épreuves mesurées...). On peut procéder de deux manières suivant les besoins.
Première manière
4 équipes homogènes : 2 fortes, 2 faibles.
Seconde manière
3 ou 4 équipes hétérogènes : forts et moins forts, garçons et filles répartis dans tous les groupes.
II faut éviter de laisser les enfants se placer par affinités, car souvent les plus forts se regroupent d'où un déséquilibre des équipes. Chez ceux qui sont choisis les derniers, s'installe un sentiment d'incompétence qui les amène à se désintéresser de l'activité.
Certains enseignants répugnent à se servir du jeu comme moyen permettant de tendre vers les grands objectifs de l'éducation physique.
S'il est vrai que la motricité inhérente à ce type d'activité se résume surtout à des actions élémentaires comme courir et lancer, l'influence sur les autres pôles des conduites motrices est très importante.
Exemple,
‑ Pôle cognitif
compréhension de la règle,
mémorisation de cette règle,
capacités d'anticipation et de décision,
compréhension des stratégies à mettre en oeuvre.
‑ Pôle affectif
respect des règles et des contraintes de l'activité,
maîtrise de l'agressivité.
‑ Pôle social
développement des modes relationnels de coopération et d'opposition.
Le rôle de l'enseignant est évidemment modifié. II doit dépasser le comportement de l'animateur pour devenir un véritable éducateur en intervenant avant et surtout après l'activité, sur les différents objectifs cités ci‑dessus.
En résumé, s'il n'y a pas un véritable apprentissage moteur au sens « d'acquisitions de nouvelles habiletés » ‑ on sait quand même qu'un enfant qui joue se muscle et qu'il y a donc contribution à son développement physique et au maintien de sa bonne santé ‑, les répercussions sur son éducation sont capitales.
Le désir de se conformer à des modèles, à cet âge, fait que les jeux dits traditionnels ont beaucoup de succès au cycle 3.
Il s'agit d'appeler un joueur tout en lançant la balle verticalement. Celui‑ci doit récupérer le ballon et essayer de toucher les autres joueurs qui, entre temps, se sont sauvés (placement de départ en cercle autour du lanceur).

Variantes
‑ permettre un rebond avant la récupération, ‑ poser le ballon au sol au lieu de le lancer.
En début d'année, ce jeu permet aux élèves d'une même classe de se connaître. Il peut également être joué face à un mur mais le nombre de joueur doit être réduit.
La classe est divisée en 4 équipes. Un élève tient le rôle du joker. II se tient au centre d'un carré de 15mètres de côté. A chaque coin se trouve une équipe. Au signal du meneur de jeu, les enfants changent de place. A lui seul, le joker représente une équipe entière. Les joueurs arrivés derniers dans un coin se retrouvent au centre, etc.
Un contre un.
Trois contre trois : les joueurs forment de petites colonnes. Le dernier de chaque colonne porte un foulard glissé dans sa ceinture. Seul le premier de « la chenille » a le droit de prise.

C'est à peu près la même règle que les écureuils en cage car les joueurs se tiennent chacun dans un cerceau sauf trois d'entre eux qui sont les chats. A chaque changement de cerceau, les écureuils sont vulnérables et deviennent chats s'ils sont touchés. Les chats sont visibles car ils doivent tenir un foulard de couleur à la main.
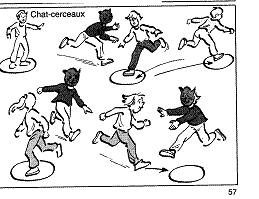
‑ Quelle couleur pour traverser la mer (jeu pour le début du cycle).
Règle principale de l'épervier mais les joueurs ont chacun un foulard de couleur (quatre couleurs différentes). Le meneur de jeu qui a un échantillon de ces couleurs, lève un foulard à chaque passage des joueurs. Ceux dont la couleur de foulard correspond à celle du foulard du meneur de jeu sont invulnérables. Eux seuls peuvent traverser le terrain en marchant.
La moitié des joueurs se trouve être cavalier, l'autre moitié cheval. Les cavaliers montent sur le dos des chevaux et s'échangent le ballon. Quand ce dernier n'est pas rattrapé, les cavaliers descendent de cheval, se sauvent. Les chevaux ayant ramassé le ballon, essaient de toucher l'un des cavaliers par un lancer.
Le gorille se tient derrière la ligne du terrain de jeu. II doit trouver, en posant des questions, le nombre exact du cadenas à chiffres qui ferme sa cage. Ce nombre a été choisi secrètement par les autres joueurs. Au moment du questionnement, ces joueurs se trouvent à 3‑4 mètres du gorille et lui répondent par « plus » ou « moins ». Quand le nombre est trouvé, le gorille poursuit les autres joueurs jusqu'à un refuge défini à l'avance. Chaque élève devient gorille à son tour.

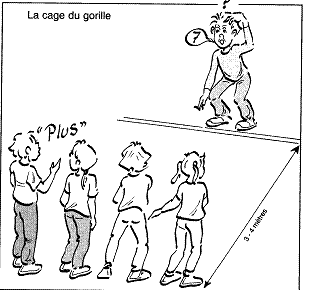
Les élèves sont rangés en quatre colonnes. Les premiers de chaque colonne ont un ballon en mains. Le but du jeu est d'aller vite au cours de la manipulation suivante: le ballon passe entre les jambes écartées des joueurs. Le dernier ramène le ballon devant le premier de colonne et le fait rouler à son tour, etc.
La manche se termine quand l'équipe se retrouve dans la même disposition qu'au début.
Variantes
‑ à l'aller, le ballon passe de mains en mains au‑dessus de la tête, au retour il est conduit au pied,
‑ à l'aller, le ballon passe de mains en mains sur le côté, au retour le joueur saute à pieds joints, le ballon coincé entre ses genoux,
‑ à l'aller, même passage que ci‑dessus, au retour le joueur passe au‑dessus de ses camarades qui se seront couchés au sol à son signal et qui se relèvent pour un nouvel aller du ballon de mains en mains.
Réussir à lancer, en faisant glisser au sol, des anneaux de caoutchouc jusqu'à une certaine zone (dans un gymnase, demi‑cercles du terrain de basket‑ball).
Jeu défi entre deux joueurs, à qui en lancera le plus dans la zone choisie.
Jeu par équipes (anneaux de couleur différente). Même règle que ci‑dessus mais les joueurs d'une équipe ont le droit, en lançant, de pousser les anneaux de l'adversaire hors zone. On comptabilise les lancers valables.
Par deux, le lanceur envoie l'anneau à plat à son partenaire placé à 3 mètres qui essaie de le rattraper autour de son bras tendu. On y ajoute le procédé de l'échelle : si l'anneau est rattrapé, le receveur recule d'un pas ; s'il y a échec, il reste sur place.
Après dix lancers, les élèves constatent: qui est le plus éloigné?
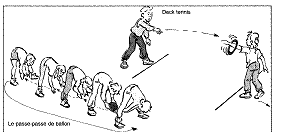
Ce sont des jeux traditionnels nécessitant beaucoup de place, préfigurant certains sports (thèqueàbase‑ball) ou des situations ponctuelles de jeu (gagne‑terrainàrugby)Leur intérêt pédagogique :
‑ ils se jouent en plein air,
‑ ils imposent une occupation équilibrée des zones de jeu,
‑ ils nécessitent une bonne appréciation des trajectoires, et la recherche des zones faibles de l'adversaire,
‑ ils amènent des situations de coopération.
Deux équipes séparées, un ballon.
Le but du jeu est de gagner du terrain vers le camp adverse.
Le joueur d'une équipe lance le ballon le plus loin possible en avant. L'un des joueurs du camp adverse le renvoie à son tour, vers l'autre camp et ainsi de suite.
‑ Si le ballon a été simplement arrêté, il est renvoyé de l'endroit où il a été touché.
‑ Si le ballon est bloqué, le joueur qui vient de le recevoir a droit à trois pas d'élan avant de le relancer.
Un point est marqué quand le ballon tombe directement dans l'en‑but de l'adversaire.
Le jeu se joue au pied ou à la main, avec un ballon rond ou ovale.
Une équipe de lanceurs L, une équipe de receveurs R.
Le premier des lanceurs envoie le ballon le plus loin possible dans le secteur de jeu puis part en courant autour du pentagone. Les joueurs R récupèrent le ballon et par passes successives, le donnent à leur capitaine. À ce moment‑là, le joueur L doit être arrêté à une base. Il marque autant de points que de bases dépassées. Total par équipes.
Changement de rôle quand toute l'équipe des lanceurs a joué.
La partie se joue au pied ou à la main, avec des ballons divers.
. Variante: La balle diabolique (ballon de rugby)
Même principe, mais il n'y a pas de pentagone tracé au sol.
‑ Le lanceur tourne autour de son équipe serrée en colonne. L'équipe marque autant de points que de tours complets effectués par le lanceur.
‑ Les receveurs forment une colonne derrière leur récupérateur et se passent le ballon entre les jambes jusqu'au dernier qui crie « stop ».
Le reste est sans changement (total des points par équipe avant d'inverser les rôles).

Ce sont des jeux traditionnels dans lesquels la réflexion tactique, individuelle ou collective, est très importante pour trouver des conduites efficaces.
À l'occasion de ce jeu très connu qui consiste pour les joueurs à traverser un terrain sans se faire prendre par les éperviers, l'enseignant pourra avec profit faire réfléchir les enfants sur : quelle stratégie développer ?
De la part des éperviers
Doit‑on se répartir des zones d'intervention ‑ côte à côte, l'un devant l'autre ?
Comment placer les chaînes de prisonniers (de quatre à cinq joueurs, pas plus) ‑ en chicane, en entonnoir ‑ ? Etc.
Prévoir trois éperviers pour une classe de trente.
De la part des poursuivis
Faire prendre conscience de l'efficacité des changements de direction et des changements d'allure de course, décélérations et accélérations.
Variante : L'épervier‑ballon
Même principe de jeu que ci‑dessus mais les éperviers ont chacun en main un ballon avec lequel ils essaient de toucher les autres joueurs.

Les chasseurs tuent les moineaux qui mangent les abeilles, lesquelles piquent les chasseurs ; chaque groupe est à la fois dominant et dominé. Les joueurs touchés sont éliminés. Sur un terrain assez grand, il faudra prévoir des refuges dans lesquels les élèves pourront se reposer un moment.
L'essentiel de la stratégie tient dans le choix de dépassement de la zone dangereuse pour être soi‑même en position favorable par rapport au troisième groupe. Individuellement, chacun doit utiliser des changements de direction et d'allure, des feintes, etc.
Les foulards sont posés au sol dans un cercle de 2 mètres de diamètre. Autour de cette zone, se trouvent quatre défenseurs. Les voleurs essaient de prendre les foulards (un par un) sans être touchés par les défenseurs. Des zones refuges sont prévues pour le repos momentané des attaquants.
Stratégies possibles
‑ attaquer tous ensemble,
‑ faire des courses latérales pour dégager la zone des foulards,
‑ attaquer le défenseur le moins vif...
Les chasseurs sont dispersés dans le terrain et placés dans des cerceaux ou cercles tracés à la craie, dont ils ne peuvent sortir que pour aller chercher la balle et non pour tirer vers les lapins. Le tir ne peut se faire que pieds dans le cerceau. La présence du ballon fait que les lapins vont essayer de se tenir à l'opposé de celui‑ci. Cette situation impose de la part des chasseurs un jeu de passes jusqu'à repousser les lapins dans un coin du terrain avant un tir payant.
On n'éliminera pas les lapins mais on comptera un point par tir réussi. On comptabilisera les points au bout de 2 minutes.
L'intérêt éducatif de ces jeux traditionnels, dont la liste est longue, ne peut être effectif que s'ils sont « traités » par l'enseignant qui ne se contentera pas, en la circonstance, de simplement animer.
À chaque arrêt de jeu, il est bon de faire réfléchir et faire parler les élèves et non leur donner des solutions toutes faites. Montrer en exemple les conduites motrices les mieux adaptées. Les choix de stratégies les plus judicieux permettront à tous les enfants de progresser en comprenant ce qu'ils font et ce qu'ils doivent faire.
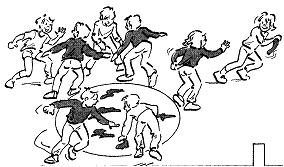
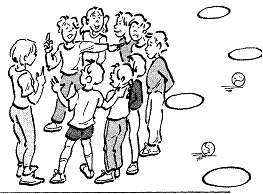
Les jeux expliqués ci‑après sont des jeux fondamentaux que tout enseignant doit pouvoir apprendre à sa classe. Les règles sont simples, les variantes souvent nombreuses, permettant de relancer l'activité.
A la fin du cycle 3, il est même judicieux d'évaluer chaque enfant sur sa capacité à nommer au moins cinq jeux connus, à en donner les règles précises ainsi qu'une ou deux variantes) possibles) pour chacun.
‑ Matériel: 1 ballon. ‑ Deux équipes O et X. Un terrain rectangulaire est divisé en deux camps.
Les prisonniers sont placés en arrière du camp adverse. L'engagement se fait au centre entre deux joueurs. Celui qui renvoie le ballon dans son camp permet à son équipe le premier tir.
Le but est de faire des prisonniers pour marquer des points.
Tout joueur touché de volée (c'est‑à‑dire avant que le ballon tombe à terre) par le ballon, est prisonnier.
Si le ballon touche le sol avant de toucher un joueur, il appartient au camp dans lequel il a touché terre. II doit être ramassé de suite et joué.
Délivrance des prisonniers
‑ Le camp a le ballon : envoyer le ballon à un partenaire qui essaiera de toucher un joueur adverse. S'il le touche, il se délivre et le joueur touché est prisonnier à son tour.
‑ Le camp reçoit le ballon : un joueur de ce camp le bloque de volée et le joueur fait prisonnier depuis le plus de temps est délivré.
Les passes sont autorisées.
II est également possible de mettre les prisonniers sur l'un des grands côtés du terrain.
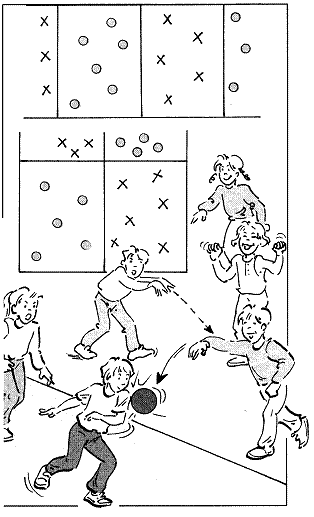
‑ Matériel: une balle ou un ballon.
‑ Les joueurs sont en cercle sur un terrain délimité. L'arbitre est au centre et lance la balle verticalement en appelant un joueur. Ce joueur s'empare de la balle (tous les autres se sauvent) et doit essayer d'attraper un autre joueur, de volée (avec la balle sans qu'elle tombe par terre).
Si le joueur est touché, il devient également chasseur et va aider le premier chasseur à attraper les autres joueurs en faisant des passes successives. Tout joueur devenu chasseur doit le montrer par un signe distinctif, comme par exemple le port d'un foulard.
Lorsqu'il veut tirer, il n'a droit qu'à trois pas de déplacement avec la balle en main. II n'a le droit de reprendre ses déplacements que lorsqu'il a passé la balle ou qu'il l'a tirée.
Variante 1
‑ Tous les joueurs sont en cercle. Trois d'entre eux, désignés à l'avance, sont les chasseurs. L'un deux a la balle en main. Au premier commandement, les joueurs (sauf les chasseurs), se dispersent dans tous les sens. Au second commandement, les chasseurs essaient en se faisant des passes, de toucher un joueur de volée.
‑ Si un joueur est effectivement touché, il doit rester dans la position où il était au moment où la balle l'a touché. Pendant ce temps, les chasseurs continuent leurs passes et leurs tirs et tous les joueurs touchés restent dans la position où ils se trouvaient.
‑ Ils y restent jusqu'à l'arrêt du jeu. Trois autres chasseurs sont désignés pour le jeu suivant. Le groupe de chasseurs qui a touché le plus de joueurs a gagné.
‑ Limiter le terrain, ‑ limiter la durée du jeu (30 secondes à une minute).
Variante 2
Les règles sont identiques à celles du jeu type, les chasseurs se passant la balle (sans la garder s'ils se déplacent) et les autres joueurs évitent d'être marqués de trop près par l'un ou l'autre chasseur. Au commandement de l'arbitre, tous les joueurs, chasseurs compris, s'arrêtent, et à ce moment‑là seulement, les chasseurs ont le droit d'essayer de toucher un joueur. Lorsque tous les joueurs sont arrêtés, les chasseurs n'ont plus droit qu'à trois passes et à un tir.

‑ Matériel: un fanion, un brassard.
‑ Deux équipes X et O, les défenseurs étant les X, les attaquants les O. Les O doivent essayer de prendre un drapeau 1 placé entre 6 et 10 m du camp des défenseurs, et de le porter dans leur camp. Un joueur attaquant o portant un brassard peut prendre les défenseurs. Tous les défenseurs X ont droit de prise sur les attaquants O. Le joueur attaquant O est intouchable.
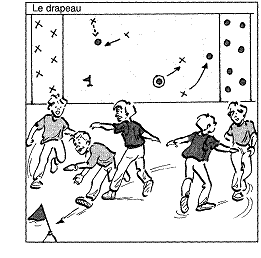
‑ La partie est gagnée par les défenseurs X : si l'attaquant O est pris porteur du drapeau ou si la moitié des attaquants O est prisonnière.
‑ La partie est gagnée par les attaquants O : si le drapeau est porté dans leur camp ou si la moitié des défenseurs X est prisonnière.
Faire changer de rôle. Le drapeau peut être passé de main en main.
Le joueur O doit être résistant car son rôle est très essoufflant.
‑ Matériel: aucun.
‑ Les joueurs disposent de deux camps A et B. Un joueur est désigné comme « épervier ». Au signal, les O quittent le camp A pour atteindre le camp B sans se faire toucher mais ils n'ont pas le droit de retourner en arrière pour ne pas être pris par l'épervier. Puis de B, ils iront en A et ainsi de suite. Tout joueur pris forme une chaîne avec l'épervier. Seuls, ceux placés aux extrémités ont droit de prise. La chaîne peut être cassée durant les traversées, et tant qu'elle n'est pas reformée, le passage est libre.

Variante 1
Les règles et le dispositif sont identiques au jeu de base mais dès que la chaîne dépasse trois joueurs, plusieurs chaînes sont formées qui ont toutes droit de prise.
Variante 2 ‑ Matériel: des foulards de deux couleurs différentes.
‑ Deux équipes X et O. Deux éperviers, un pour chaque équipe. Lorsque les X et les O traversent le terrain, chaque épervier essaie de toucher les joueurs de l'équipe adverse. Deux chaînes se forment (une chaîne pour chaque équipe), servent de rabatteurs à leurs éperviers qui restent seuls et n'ont pas droit de prise. Elles constituent un mur, naturellement mobile, que les joueurs adverses doivent contourner. Une chaîne cassée ne peut gêner un joueur adverse.
L'équipe gagnante est celle dont la chaîne est la moins longue.
‑ Matériel: des foulards pour les sorciers.
‑ Désigner un sorcier pour 4 à 5 joueurs. Les sorciers doivent, dans un temps déterminé, toucher le plus grand nombre de joueurs. Les joueurs pris doivent s'arrêter sur place et croiser les bras.
En fin de partie (limitée à une minute car le jeu est très fatigant), compter le nombre de joueurs pris, puis changer les sorciers et recommencer.
Variante 1
La règle est identique au jeu type mais les joueurs « pétrifiés » peuvent être délivrés par leurs camarades d'une façon convenue à l'avance : deux tapes sur le bras, passer entre les jambes écartées des joueurs, etc.
En fin de partie, compter les joueurs qui seront restés pris.
Variante 2
Trois équipes X, O et Z. Une équipe est « sorcier ». Les règles sont les mêmes que celles du jeu de base. Les autres équipes sont solidaires les unes des autres contre les sorciers. Ce qui signifie que si l'équipe X est « sorcier », elle peut toucher indifféremment O ou Z, mais O et Z peuvent se délivrer mutuellement.
L'équipe qui a réussi à pétrifier le plus grand nombre de joueurs est gagnante.
‑ Matériel: deux balles ou deux ballons pour une demiclasse.
‑ Deux équipes X et O. Devant chaque équipe, un joueur numéroté 1 est placé à quelques mètres avec une balle en main.
Au commandement, les joueurs 1 lancent la balle ou le ballon au n° 2 qui la lui renvoie et s'assoit. Le n° 1 lance alors la balle au n° 3 qui la lui relance et s'assoit, etc.
Le dernier reçoit la balle et la relance immédiatement (donc ne s'assoit pas) au joueur n° 1, qui l'envoie alors à l'avantdernier, qui se sera relevé dès qu'il aura vu que la balle a été relancée par celui qui était derrière lui.
La partie est gagnée lorsque, tous étant debout, le joueur n° 2 renvoie la balle au n° 1.
Remarques
La distance du n° 1 au n° 2 est fonction
‑ de l'objet lancé (balle ou ballon),
‑ du nombre d'élèves en colonne. Elle peut varier de 1 à 10 mètres.
Les deux derniers doivent être au même niveau.
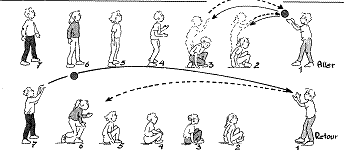
‑ Matériel: un ballon, quatre quilles.
‑ Les joueurs sont en cercle. Au centre, se trouvent quatre quilles et un gardien qui doit toujours avoir les quilles (le château) derrière lui. Les joueurs lancent uniquement le ballon à la main, mais le gardien peut le renvoyer avec les mains, les pieds ou la tête.
Les passes sont autorisées entre les joueurs du cercle pour surprendre le gardien. Les joueurs doivent tirer de leur place pour démolir le château. Le gardien ne peut ramasser une quille tombée que s'il attrape le ballon de volée. II reconstruit alors le château après avoir renvoyé le ballon hors du cercle.
Lorsque 3 quilles sont tombées et (non ramassées), le gardien est remplacé par le joueur qui fait tomber la dernière quille.
Remarques
Lorsque le gardien a le ballon en main, il l'envoie dans les mains d'un des joueurs du cercle,
Veiller à ce que tous les joueurs aient le ballon, soit pour des passes soit pour un tir. Toute quille tombée par la faute du gardien compte. Choisir le gardien parmi les enfants les plus résistants.
Variante 1
Mêmes règles et même dispositif que pour le jeu type mais il y a deux gardiens qui ont tous les deux le droit de bloquer le ballon. C'est celui qui bloque qui doit relever la ou les quilles. Ce jeu convient particulièrement aux plus jeunes, l'effort combiné des 2 gardiens le rend moins intense.
Variante 2
Même dispositif mais cette fois, on joue au pied. Le ou les gardiens) ne peut (peuvent) renvoyer qu'au pied. Le ballon ne doit être envoyé hors du cercle que s'il a été bloqué correctement sans utiliser tes mains.

Basket‑ball, handball, football, ultimate et unihoc
II nous semble intéressant de repréciser les règles adaptées de ces cinq sports collectifs les plus pratiqués à l'école élémentaire. Ces règles seront davantage simplifiées, si besoin est, suivant
‑ le niveau des enfants,
‑ leur place dans l'unité d'apprentissage (très simples au départ, plus complexes à la fin du cycle).
Tous les enfants devront être capables, à la fin du cycle 3, non seulement d'énoncer les principales règles des sports collectifs qu'ils auront pratiqués à l'école, mais également de les mettre à exécution. C'est pourquoi l'arbitrage est très important car il aide l'élève à mémoriser les pratiques courantes ainsi que les interdits. Ce qui lui permet dans un second temps de dénoncer les fautes et de déterminer les sanctions qui s'imposent. Cet arbitrage, tant individuel que collectif, ne devra s'effectuer que dans un contexte positif, chacun comprenant qu'il est nécessaire pour que le jeu soit le plus parfait possible.
Deux équipes de cinq joueurs. La mise en jeu se fait par un entre‑deux.
‑ Le ballon n'est utilisé qu'à la main.
‑ On ne peut se déplacer avec le ballon qu'en dribblant.
‑ On ne peut garder le ballon plus de 5 secondes sans tirer ou passer.
‑ On ne peut rester dans la raquette plus de 3 secondes.
‑ On ne bouscule pas ses adversaires. Lorsqu'un panier est réussi, la remise en jeu se fait derrière la ligne de fond. Les fautes comme le ballon hors‑jeu, le marcher, les 3 secondes sous le panier, la reprise de dribble, le dribble à deux mains ou la faute personnelle qui n'empêche pas la réussite d'un tir, entraînent la remise en jeu par l'adversaire sur la ligne de touche.
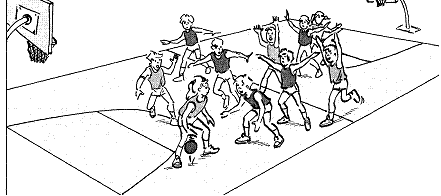
Deux équipes de sept joueurs. La mise en jeu se fait au centre après tirage au sort.
‑ Le ballon n'est utilisé qu'à la main, sauf le gardien qui peut utiliser ses pieds.
‑ On ne peut se déplacer avec le ballon qu'en dribblant (trois appuis sont autorisés sans dribble).
‑ On ne peut garder le ballon plus de 3 secondes (sauf si l'on dribble).
‑ On ne bouscule pas ses adversaires.
‑ On ne peut entrer dans la zone.
Les fautes comme le marcher, les 3 secondes, la reprise de dribble, le passage en zone entraînent le jet franc à l'endroit de la faute (pénalty si c'est un défenseur).
Deux équipes de sept joueurs. Après tirage au sort, l'engagement se fait par l'une des deux équipes dont un joueur passera le ballon à l'un de ses partenaires proche.
‑ Le ballon n'est utilisé qu'au pied (sauf pour le gardien qui peut recevoir et remettre en jeu à la main).
‑ Un but est marqué si le ballon est envoyé dans les cages sans qu'il y ait hors‑jeu.
Règle du hors‑jeu simplifié: un joueur attaquant est hors‑jeu s'il se trouve dans la zone ligne de but ‑ ligne tracée à 13 m du but et s'il n'y a. pas de défenseur entre lui et le but.
‑ Les remises en jeu
‑ lorsque le ballon sort du terrain sur les côtés (ligne de touche), la remise en jeu est faite à la main par un joueur de l'équipe adverse à l'endroit où le ballon est sorti,
‑ lorsque le ballon sort du terrain derrière la ligne de but, il ya:
. corner si un défenseur a touché le ballon en dernier; dans ce cas, la remise en jeu se fait à l'angle du terrain du côté où le ballon est sorti,
. sortie de but si un attaquant a touché le ballon en dernier ; dans ce cas, la remise en jeu se fait par le gardien au pied, à (au plus) 6 m de la ligne de but.
‑ à l'engagement ou après chaque but, la remise en jeu s'effectue au centre du terrain dans le rond central, le ballon devant être joué vers l'avant.
‑ On ne bouscule pas, on ne fait pas tomber ses adversaires.
‑ On n'envoie pas le ballon hors des limites du terrain.
Si ces règles ne sont pas respectées, l'équipe n'ayant pas commis la faute réalise un coup franc direct à l'endroit de la faute (le joueur peut marquer directement un but).
‑ On n'est pas en position de hors‑jeu.
Si cette règle n'est pas respectée, l'équipe n'ayant pas commis la faute réalise un coup franc indirect à l'endroit de la faute (le joueur ne peut dans ce cas marquer directement un but).
Lorsqu'un joueur bouscule ou fait tomber un adversaire dans la zone de hors‑jeu, il y a pénalty, c'est‑à‑dire que le ballon sera tiré à 9 m du but sans que les défenseurs (sauf le gardien) puissent s'interposer (et cela, quelle que soit sa position au moment de la faute).
Remarque
Les dimensions idéales d'un terrain pour le football à sept sont les suivantes: longueur: 50 à 75 m, largeur: 45 à 55 m (c'est‑à‑dire les dimensions d'un demi‑terrain de football à 11). Cependant, il n'est pas toujours possible de jouer sur un tel terrain, et bien souvent la cour de récréation sert de surface de jeu. Dans ce cas, les dimensions étant plus petites, les remises en jeu se feront toutes à la main.
Deux équipes de sept joueurs.
Terrain de 100 m de long sur 35 m de large. Deux zones de but de 25 m, incluses dans ces 100 mètres. A modifier pour que les situations soient jouables par les enfants (les dimensions ci‑dessus étant données à titre indicatif) et pour que les proportions soient respectées.
Le jeu consiste pour chaque équipe, au moyen de passes, à recevoir le frisbee dans la zone adverse.
‑ On ne marche pas, on ne court pas quand on a le frisbee.
‑ Aucun contact n'est autorisé.
‑ On ne peut être plus d'un joueur face à face avec le porteur du disque.
‑ Les joueurs eux‑mêmes annoncent les fautes.
C'est un sport collectif où les filles peuvent parfaitement se rendre compte qu'elles tiennent leur place. La confiance qu'elles acquièrent les amène à un comportement identique à celui des garçons.
Deux équipes de six joueurs. La mise en jeu se fait de la façon suivante : la balle tombe entre deux enfants qui la jouent après le rebond.
‑ On a le droit de frapper la balle avec les deux côtés de la crosse.
‑ On a le droit d'arrêter la balle avec le pied ou la crosse.
‑ On peut prendre la balle à un adversaire.
Mais il est interdit de
‑ lever la crosse au‑dessus du genou,
‑ faire une passe avec le pied,
‑ bousculer, frapper de quelque manière que ce soit ses adversaires,
‑ d'être dans la zone de but.
Les fautes sont sanctionnées par un coup franc, qui s'effectue à l'endroit où la faute a été commise, mais pas directement vers le but. Concernant le cas où un joueur se trouve dans la zone de but: il y aura coup franc pour les attaquants, penalty pour les défenseurs (c'est un coup franc direct tiré à 7 m du but ; aucun joueur entre la balle et la ligne de but d'où se fera ensuite la remise en jeu mais à l'extérieur du but lui‑même).
Motivés par des jeux tels que « Transmettre un message » (Thèmes transversaux cycles 1 et 2, page 43), les élèves pourront aborder les courses de relais d'une manière plus sportive.
Diviser sa classe en trois ou quatre équipes suivant la longueur de la piste et prévoir 50 m de course pour chaque élève, d'où des places de départ différentes. Exemple : trois équipes de huit sur une piste de 200 m.
Demander au relayeur de tendre son bras vers l'arrière, main ouverte vers le bas.
S'entraîner à toujours passer le témoin de la main gauche du relayé à la main droite du relayeur. Ce dernier va devoir, tout en courant, placer le témoin dans sa main gauche pour la prochaine transmission.
II est à noter que les passages de témoin main gauche dans main droite, puis main droite dans main gauche, etc., en usage au plus haut niveau de la compétition, sont difficiles à réaliser avec des enfants.
Le principal défaut étant pour le relayeur d'attendre à l'arrêt le relayé, il faut faire en sorte que les vitesses des deux coureurs s'additionnent. Ce qui signifie qu'à un moment, relayeur et relayé courent l'un à côté de l'autre pour se transmettre le témoin et surtout pas l'un devant l'autre (risque de chute).
Le n° 1 de chacune des quatre équipes part en courant autour du cercle, puis contourne sa propre équipe et vient se placer devant sa colonne. C'est le signal de départ pour le n° 2 qui fait le même parcours, etc.
À chaque nouvelle arrivée d'un coureur, la colonne recule d'un pas.
Deux équipes, l'une numérotée 1, l'autre 2.
Sur le terrain, deux plots sont placés entre les lignes de départ des deux groupes. La ligne qui joint les deux plots est matérialisée au sol.
‑ Les n° 1 partent en courant.
‑ Lorsqu'ils passent sur la ligne pointillée, les n° 2 partent à leur tour.
‑ Les n° 1 rejoignent les n° 2. ‑ Ils courent à côté d'eux à leur droite.
‑ Les n° 1 donnent trois tapes sur l'épaule droite de leur partenaire.
‑ Enfin, les n° 2 accélèrent pendant que les n° 1 s'arrêtent. On fait exécuter l'exercice en sens inverse, chaque n° 2 rejoignant son n° 1, en exigeant que les deux coureurs soient décalés latéralement l'un par rapport à l'autre, le relayé passant toujours à droite du relayeur. D'où la nécessité d'une bonne maîtrise de la latéralité chez les enfants.
II est quelquefois difficile de dissocier des objectifs tels que respect des règles et coopération, mais il est évident que dans les sports abordés ci‑après, ce deuxième thème est dominant.
Dans un premier temps, on ne peut que laisser passer la période pendant laquelle les enfants courent derrière le ballon dans tous les coins du terrain, et s'y agglutinent en grappe. C'est l'occasion pour en tirer des enseignements utiles (sur la dispersion, l'occupation du terrain...).
Dans un second temps, il faut faire comprendre aux joueurs d'une même équipe qu'ils doivent avoir le même comportement dans le jeu. On ne peut être efficace si certains se placent en défense regroupée et si d'autres poursuivent le porteur de ballon adverse.
Pour en revenir à la différenciation des rôles évoqués ci dessus, la question reste posée : doit‑on s'appuyer sur les motivations de chacun et sur ses capacités, en acceptant ainsi que les plus habiles tiennent les rôles les plus valorisants (les avants) pendant que les moins débrouillés (ou les filles, malheureusement) restent cantonnés dans des rôles plus obscurs (les arrières) ? Ou bien doit‑on faire en sorte que chacun joue successivement tous les rôles, de manière à ce que l'activité soit vraiment éducative ? II faut pour cela que l'ambiance de la classe s'y prête. On va donc s'attacher à ce que tous les élèves acquièrent des principes de jeu qui sont souvent identiques et transposables d'un sport à l'autre, dans une sorte de tronc commun.
‑ Le ballon château (pour plus de précision, cf. jeux à connaître, même chapitre).
Les joueurs du cercle doivent renverser 5 quilles par un tir, sans s'approcher. Un joueur de l'équipe opposée est le gardien du château.
Ce jeu nécessite évidemment d'aller plus vite que le déplacement du gardien, d'où une suite de passes rapide. Par ailleurs, le défenseur du château est amené à avoir un comportement de gardien de but.
‑ La passe à dix sans adversaire
Quatre terrains accolés, quatre équipes, quatre ballons. Se faire le plus rapidement possible dix passes à la main dans chaque équipe sans que le ballon tombe par terre et sans que les joueurs soient immobiles (ils doivent trottiner).
‑ La passe à dix avec intercepteur
Chaque équipe envoie dans l'équipe voisine un joueur qui va gêner le jeu de passe (s'il touche la balle, le total des passes revient à zéro et les passeurs doivent recommencer).
À chaque nouvelle manche l'enseignant augmente le nombre des intercepteurs jusqu'à arriver à égalité de nombre.
‑ La passe à dix
Elle se joue entre équipes de même nombre de joueurs. Quand il y a interception, les joueurs en possession de la balle essaient à leur tour d'aller jusqu'à la dixième passe et ainsi de suite.
. Remarque
À l'occasion de ces jeux, on doit faire dire et comprendre que
‑ le porteur du ballon doit s'arrêter pour voir tous ses partenaires avant de passer la balle et trouver la bonne distance de passe,
‑ les non‑porteurs du ballon doivent se disperser, occuper tout le terrain, éviter la situation d'alignement, s'écarter de l'adversaire (se démarquer),
‑ le porteur du ballon doit faire des passes rapides et correctes techniquement (ni trop hautes, ni trop basses, ni déviées...),
‑ il doit varier selon les circonstances les types de passes (par exemple, à rebond) et éviter les passes en « cloche » qui donnent le temps à l'adversaire de se replacer.
Inversement si l'on doit prendre la balle à l'adversaire, il faut se rapprocher de ceux qui peuvent le recevoir avec le maximum de probabilité, anticiper les intentions du passeur (en suivant la direction de son regard par exemple).
Ce jeu étant très intense, il faudra prévoir de fréquentes coupures (pendant lesquelles les enfants s'expriment).
On peut aussi jouer au pied mais les ambitions doivent être moindres (passe à 5) et il faut interdire de prendre la balle dans les pieds de celui qui la possède.
La caractéristique des sports collectifs, c'est d'aller marquer un but, un panier, un essai dans le terrain de l'adversaire. C'est dire que les déplacements des attaquants sont orientés, d'où cette notion importante de progression vers le but adverse.
‑ La balle au capitaine
Deux équipes s'opposent sur un terrain divisé en deux, se terminant de chaque côté par deux zones plus étroites dans lesquelles seuls évoluent les capitaines.
Le but du jeu est, tout en respectant quelques règles essentielles (on ne se déplace pas en portant la balle, on n'agresse pas le porteur du ballon) d'amener le ballon à son propre capitaine qui se trouve dans la zone à l'opposé de la position de départ de l'équipe.
Variante : la zone longue et étroite est remplacée par une zone arrondie, interdite à tout joueur, le capitaine se trouvant au fond de cette zone, immobile à l'intérieur d'un cerceau.
‑ Le rapporte ballon
Une équipe est seule sur le terrain. Près de son but, se trouve un carton avec quatre ballons. Dans un temps le plus court possible, il s'agit, en prenant les ballons les uns après les autres, d'aller marquer quatre points dans le but de l'adversaire. Les règles à respecter sont celles du sport collectif envisagé (on ne marche pas avec la balle si c'est un sport de main) ainsi que celles propres à ce jeu : chacun doit recevoir la balle au moins une fois. Tout le monde passe la ligne médiane du terrain, en attaque et aussi dans l'autre sens lorsqu'on revient chercher le ballon suivant.
On peut y adjoindre une évaluation des habiletés par un système de pénalités : 5 secondes de plus au temps total pour un tir en dehors du but ou à trajectoire non tendue (handball), un panier non réussi, un ballon perdu hors limite (basket-ball), etc.
Le jeu peut être pratiqué avec un ballon de handball ou de basket-ball ou même au pied.
‑ Adaptation du jeu appelé « bleu et rouge »
Sur un terrain de handball, deux équipes nettement différenciées par des couleurs de maillot sont mêlées autour du meneur de jeu. En appelant une couleur, ce meneur jette le ballon en l'air. Les joueurs concernés s'en emparent, alors que les autres doivent impérativement aller se placer en défenseurs devant la zone de handball, leur gardien entrant rapidement dans les buts. Les attaquants doivent progresser vers la zone adverse et concrétiser leur déplacement par un tir réussi. Le jeu recommence après le tir, soit en appelant les mêmes, soit en appelant l'équipe adverse.
Pour tous ces jeux, l'enseignant doit faire en sorte que ses élèves jouent souvent, donc il faut éviter les équipes à gros effectif et si possible dédoubler les surfaces de jeu.
 l'occasion d'une situation d'attaque‑défense devant un seul but, chercher à intercepter le ballon et développer une contre‑attaque à un ou deux joueurs, le but de l'adversaire n'étant défendu que par le gardien (handball, football) ou par un seul défenseur (basket-ball).
En utilisant le procédé pédagogique du jeu arrêté (tout le monde s'arrête au coup de sifflet de l'arbitre), faire constater aux élèves qu'ils sont capables ou non de respecter les consignes données par l'enseignant pendant une période de jeu réel : équilibre dans l'occupation du terrain, placement des défenseurs entre le ballon et leur propre but, marquage rapproché de l'adversaire dès qu'il a franchi la ligne médiane selon le type de défense choisi d'une part, recherche du surnombre sur une aile pour les attaquants ou changement rapide du côté où l'attaque se développe, d'autre part.
Par exemple, le côté gauche de l'adversaire étant défendu, on fait parvenir le ballon rapidement vers le côté droit.
‑ Suppression du dribble
Pendant une période de jeu (handball, basket‑ball) interdire le dribble qui peut être le meilleur mais aussi le pire des gestes sportifs (par rapport au comportement collectif souhaité).
‑ Rester dans son couloir
Afin de provoquer une occupation du terrain équilibrée et empêcher aux plus habiles de monopoliser le ballon, on découpe artificiellement le terrain en couloirs longitudinaux et on assigne à chacun une zone d'intervention. ‑ Entrer en possession du ballon plus souvent Si le groupe d'élèves est important, si l'on manque de terrain (étant bien entendu qu'une pratique sportive ne sera efficace que si tous les enfants ont l'occasion de recevoir et de lancer le ballon souvent), on peut mettre en jeu un second ballon (procédé dit: multiballons).
De même, augmenter le nombre de buts (multibuts). Ce qui est surtout possible à organiser au football par exemple.
On peut inventer d'autres situations éducatives, mais il est souhaitable dans tous les cas de donner plutôt l'avantage à l'attaque.
‑ Traverser la zone des gêneurs
Après un départ de sa propre moitié de terrain, les quatre attaquants essaient d'éviter l'interception du ballon par les deux gêneurs. Terminer par un tir au but. Exemple donné avec le handball, transférable au basket‑ball, football, rugby, ultimate (les gêneurs doivent rester dans leur zone).
Ce sont des procédés connus et faciles à contrôler pour l'enseignant. On peut cependant leur reprocher d'être parfois artificiels et éloignés des structures de jeu réel (pas d'adversaire proche du porteur de ballon). Ils ne sont acceptables que dans la mesure où ils améliorent par répétition des habiletés motrices. D'où la nécessité de fréquents passages pour chaque élève. On peut citer
conduite de balle à la main en dribblant, au pied ou avec la crosse, les demi‑équipes étant rangées en colonnes face à face, les passes en carré (passer et suivre) : à la main avec le ballon ou le frisbee; ou avec la crosse; ou au pied,
Les joueurs sont placés en quinconce. Le premier joueur de l'équipe A lance l'engin. À l'autre bout de la ligne, le premier joueur de l'équipe B fait de même. Dès qu'il a attrapé l'engin, le dernier joueur de chaque équipe va se placer dans un cerceau situé à proximité.
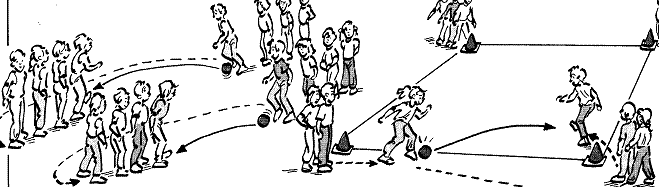
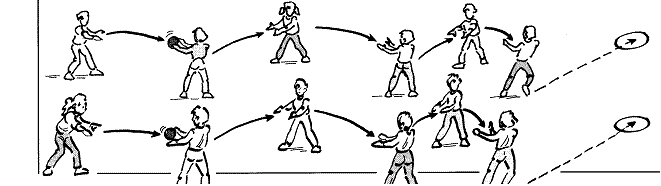
Les joueurs A se passent le ballon. Les joueurs B doivent intercepter les balles des joueurs A et développer une attaque vers le but adverse.
Disposer sur le terrain des buts lots, bancs...) défenseurs par des gardiens. Les tireurs, se tenant derrière des limites au sol, essaient de marquer des buts à la main (ballon de handball) ou au pied (ballon de football). Les tireurs changent de cible toutes les 2 minutes.
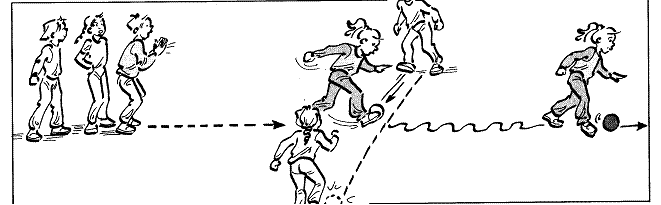
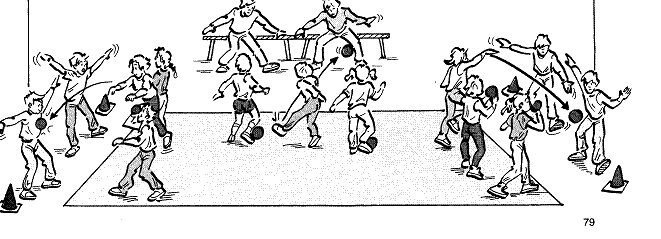
type jeune basketteur ou jeune footballeur. Ils doivent combiner plusieurs habiletés et sont chronométrés. Exemple de parcours basket


(basket‑bail, handball, football, ultimate, rugby)
Huit enfants sont placés en cercle. L'un d'entre eux a un ballon. Un neuvième joueur, le gêneur, essaie d'intercepter les passes du lanceur de ballon qui n'a pas le droit de le donner à ses deux voisins immédiats.
‑ Basket‑ball, handball
Un joueur, porteur du ballon, est face à un défenseur passif et bras levés durant les premiers essais de l'exercice. II a le choix entre tirer au panier ou contourner le défenseur en dribble pour s'approcher de la cible et tirer.
‑ Rugby
Le joueur a le choix entre faire passer le ballon par un coup de pied au‑dessus du défenseur et le reprendre ensuite, ou contourner le défenseur en le repoussant.
‑ Football
Le joueur peut soit tirer directement au but, soit donner le ballon à un partenaire qui le lui rendra pour qu'il puisse ensuite tirer au but.
Variance à trois (handball, basket‑ball, rugby).
Le porteur de ballon a le choix entre tirer tout de suite, contourner l'adversaire qui est actif ou passer la balle à un partenaire placé latéralement, qui lui rendra la balle après son déplacement (passe et tir).
Au football, il aura le choix entre tirer tout de suite, se décentrer par rapport à l'adversaire, ou passer à un partenaire placé latéralement, qui lui rendra la balle après son déplacement.
II est évident que compte tenu de l'âge des élèves, ce sport plus que tout autre, doit être pratiqué avec des règles aménagées.
On peut faire une révision des jeux traditionnels dans lesquels apparaissent les mêmes conduites motrices que dans le sport: changements de direction, courses, accélérations‑décélérations, feintes.
. Exemples
‑ L'épervier (plusieurs éperviers essaient de toucher ou de ceinturer ceux qui traversent le terrain).
‑ Jeu de chat un contre un (le joueur A essaie de traverser un terrain sans se faire prendre par le joueur B qui vient à sa rencontre).
‑ Le béret avec plusieurs ballons de Rugby (trois ou quatre). Les joueurs sont appelés les uns après les autres avec un petit décalage dans le temps, mais il n'y a pas plus d'un couple par ballon. II faut rapporter son ballon dans son camp sans se faire ceinturer (perte de point). La présence de plusieurs joueurs en même temps sur le terrain occasionne des situations d'écran permettant d'échapper à son adversaire direct.
‑ Le jeu du béret en orientant la progression vers l'en‑but adverse.

Situations spécifiques
Une équipe possède six ballons sur sa ligne de but. II lui faut les porter l'un après l'autre dans l'en‑but de l'adversaire. L'attaquant ceinturé avec le ballon en main perd le bénéfice de l'attaque. Autre cas où l'équipe perd le point
le ballon est intercepté ou roule en touche.
– La passe arrière
Deux joueurs essaient de porter la balle dans l'en‑but adverse malgré la présence d'un opposant. Si le porteur de ballon est ceinturé, le groupe des deux joueurs a perdu. De même si leurs passes ne se font pas vers l'arrière.
‑ Jeu équipe contre équipe (six contre six)
Le but du jeu est d'aller porter le ballon dans le but adverse. Si le porteur du ballon est ceinturé sans progresser, on joue une mêlée un contre un, la balle revenant à l'équipe qui a stoppé l'attaque. Le jeu au pied est interdit, les passes vers l'avant sont sanctionnées par une mêlée.
Exercices
‑ Traverser un terrain, les équipes de six ou sept joueurs étant placées en lignes. Se passer le ballon de mains en mains, vers l'arrière, du n° 1 au n° 7.
‑ Répéter cet exercice en allant de plus en plus vite.
‑ Idem en inversant la progression de la balle quand celleci est arrivée au n° 7.
‑ Idem mais par lignes de trois joueurs : le n° 1 passe la balle au n° 2, puis va se placer à côté du n° 3 et ainsi de suite (redoublement à l'aile).
‑ Progresser sur la longueur du terrain en paquet de six ou sept: le porteur du ballon donne la balle vers l'arrière puis se place derrière le groupe.
Jeu collectif
Proposer le ballon‑contact à sept contre sept tel qu'il est décrit dans l'ouvrage « L'EPS au cycle élémentaire », collection « Essai de réponses e, éditions Revue ERS. Consulter également « L'EPS au cycle moyen » dans la même collection.
Jouer avec le disque :
Les jeux individuels possibles avec le frisbee ou disque, seront traités au chapitre concernant l'habileté motrice. Ici, nous envisageons l'apprentissage du sport collectif correspondant, appelé ultimate.
On peut reprendre beaucoup de situations, jeux et exercices proposés dans le tronc commun. II suffit de respecter les règles principales de ce sport.
situations possibles ‑ Jouer à deux contre un, ‑ jouer à trois contre deux.
Ces situations vont permettre d'utiliser ou de réutiliser le pivot comme au basket. On peut déplacer autant qu'on le veut un des deux pieds à condition que l'autre reste au sol. Ceci amène une plus grande possibilité de passes.
Jeu ‑ Les prisonniers (adaptation du ballon‑prisonnier)
Un lanceur avec x disques est séparé de ses partenaires (les prisonniers) par des gardiens (l'équipe opposée). II s'agit de faire parvenir chaque frisbee un par un aux prisonniers pour les délivrer.
Jouer avec une crosse ; le unihoc
Au cycle 2, avaient été abordées des situations de conduite de balle ou de palet individuelles, d'échanges de balle ou de palet par deux et de jeu complet sans règles contraignantes, dans une pratique que l'on pouvait qualifier de « sauvage » .
Au cycle 3, l'enseignant doit structurer les conduites motrices des enfants dans un contexte collectif.
On pourra reprendre les jeux, situations, exercices du tronc commun.
Nous proposons également
. Un jeu
Conduire sa balle rapidement: rejoindre sa base.
Dans un terrain carré, on détermine quatre bases : nord, est, ouest, sud. Les joueurs disposés sur le terrain doivent rejoindre le plus rapidement possible et avec leur balle, la base annoncée par le meneur de jeu.
À chaque fois, on peut comptabiliser les points attribués aux derniers arrivés à la base ; le but du jeu étant d'avoir le plus faible total de points en fin de jeu...
‑ Une situation
Traverser un terrain par trois sans perdre sa balle malgré les gêneurs. Remplacer les défenseurs actifs par des plots placés de façon irrégulière. La progression doit se faire sans que la balle touche un plot lors des échanges. Terminer par un tir.
. Un exercice Recevoir et tirer.
Les tireurs en colonne au centre reçoivent la balle lancée par un ailier et tentent de tromper le gardien par un tir d'environ 7‑8 m (à l'extérieur de la zone de handball si l'on veut un repère en gymnase ou sur terrain de sport).
A partir des conduites apparues pendant le jeu de la thèque, on peut aisément en arriver à une pratique simplifiée du base‑ball.
1. Règles spécifiques
Le terrain : au lieu d'un pentagone, les bases forment un carré (quatre bases au lieu de cinq).
Le lancer, préalable à la course autour des bases, est en fait une interception entre un lanceur et un receveur (membres de l'équipe des défenseurs) par un attaquant qui la réalise à l'aide d'un engin, la batte (ou autre matériel à l'école élémentaire : raquette ou planche façonnée).
L'attaquant, après avoir frappé, (trois essais au plus avant l'élimination automatique) court autour du carré pour marquer un point pour son équipe (un tour = un point).
II peut cependant s'arrêter pour éviter d'être pris, à n'importe quelle base. Car il y a d'autres cas d'élimination
‑ si son lanceur est bloqué directement par un défenseur du champ,
‑ s'il est touché entre deux bases par un défenseur ayant la balle en main,
‑ si un défenseur arrive avant lui à la base où il est forcé de se rendre.
L'équipe attaquante qui a trois joueurs éliminés, change de rôle.
Les manches ou reprises se jouent par addition de points. Le match se joue en neuf reprises.
2. Le matériel
En l'absence d'une vraie batte, une raquette de tennis à manche court fera l'affaire, de même qu'une planche légère et étroite dont une extrémité aura été façonnée en poignée. On peut utiliser une balle de tennis ou une balle un peu plus grosse en caoutchouc.
3. Les capacités préalables ‑ Courir vite sur de faibles distances.
Exercice de course navette avec des parcours de 30 mètres aller et retour.
‑ La maîtrise des lancers et réceptions d'une balle de tennis.
Exercice à réaliser par deux, complété par le procédé de l'échelle (bon lancer, le lanceur recule d'un pas; mauvais lancer, il reste sur place.)
‑ La réussite du frapper avec la batte, d'une balle venant côté préférentiel du batteur entre son genou et son épaule.
4. Le match
Il est à faire jouer quand le temps est clément, car les attaquants passent à la batterie un par un. La meilleure organisation consiste à prévoir trois équipes de huit ou neuf joueurs, la troisième équipe se répartissant les rôles d'arbitre, juges de base, marqueur, etc.
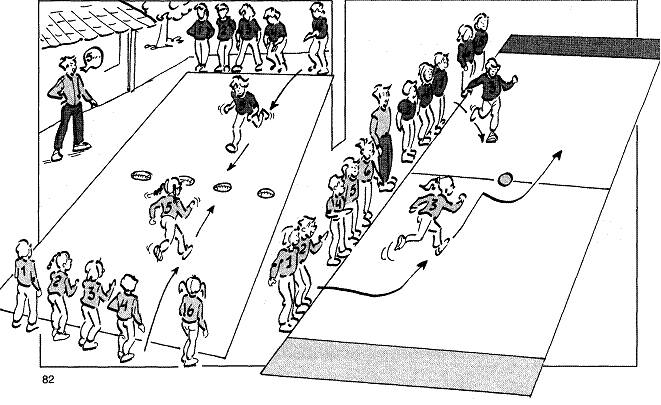
L'évaluation, qui peut être individuelle ou collective, mise en place à la suite de grilles d'observation, ne portera efficacement que sur un élément du jeu à la fois (les bonnes passes, les mauvaises, la réussite dans les tirs...).
Enfin le jeu complet, le match, sera organisé de manière à ce que les joueurs fatigués puissent être relayés par des partenaires postés sur la touche.
Autre possibilité : diviser la classe en trois groupes de niveau équilibré. Deux équipes jouent, la troisième observe et arbitre. Changer tes rôles toutes les 5 minutes, l'équipe spectatrice faisant part aux équipes joueuses de ses observations durant le jeu.
Dans tous les cas, l'enseignant veillera à ce que
‑ le terrain de jeu soit occupé de manière équilibrée,
‑ les joueurs, tout en respectant leur place, leur zone d'intervention, participent successivement selon le cours du jeu à l'attaque et à la défense :tout le monde attaque ou tout le monde défend selon que l'équipe a ou n'a pas le ballon.
Exemple d'évaluation individuelle pour le handball
1 ‑ Je réalise dix dribbles sur place sans perdre la balle.
2 ‑ Je réalise dix dribbles en me déplaçant, sans perdre la balle.
3 ‑ Je réalise cinq dribbles au moins sans regarder le ballon.
4 ‑ Je passe la balle à mes partenaires.
5 ‑ Je sais apprécier une trajectoire : mon ballon correctement lancé peut être rattrapé par un camarade.
6 ‑ Je suis capable d'empêcher la progression du ballon.
7 ‑ Je suis capable de marquer un adversaire.
8 ‑ Je suis capable d'échapper au marquage d'un adversaire.
9 ‑ Je sais sélectionner le partenaire qui me semble le plus approprié pour recevoir et renvoyer la balle.
10 ‑ Je respecte les règles du jeu.
11 ‑ Je donne quatre interdits du jeu de handball.
12 ‑ Je suis capable d'observer et de critiquer de façon justifiée le jeu de deux équipes.
13 ‑ Je m'implique totalement dans le jeu.
Remarque Cette évaluation est à simplifier en fonction de l'âge des enfants auxquels elle s'adresse.
Exemple de grille d'observation individuelle ou collective pour le handball
ÉQUIPE OBSERVÉE: |
NOMS DES JOUEURS |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Utilise tout le terrain |
|||||
Se positionne pour recevoir le ballon |
|||||
Échappe à l'adversaire |
|||||
Fait des passes à ses partenaires |
|||||
Fait des passes au moment opportun |
|||||
Favorise ou empêche la progression du ballon |
|||||
Respecte les règles |
|||||
